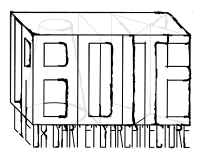- +216 71 772 000
- laboite@kilanigroupe.com
- Du lundi au vendredi, de 11h à 17h.
El Kazma I Édition 2019
Amel Ben Attia, commissaire de l’édition
Ligne floue. Point de fuite entre l’ici et l’ailleurs. Neuf conteneurs échoués, drainés là par un courant artistique contemporain fort, porté par neuf artistes visuels tunisiens et internationaux : Younes Ben Slimane, Ali Cherri, Sofian El Fani, Fakhri El Ghezal, Nicène Kossentini, Amine Koudhaï, Amine Messadi, Camille Pradon et Zineb Sedira.
L’édition 2019 d’El Kazma, est commissionnée par l’artiste Amel Ben Attia. Elle a choisi d’investir plusieurs espaces publics par le biais d’artistes vidéastes nationaux et internationaux, avec un ensemble de vidéos placées dans les cafés, les souks et les placettes (Lahwez).
Amel Ben Attia est artiste visuelle et commissaire d’exposition. Elle a validé son cursus universitaire aux beaux-arts de Tunis et successivement à Nabeul en art plastique. Elle passe de la peinture à la vidéo qu’elle explore avec la sculpture et les installations. Elle poursuit ses débuts de commissaire d’exposition avec Jaou Tunis à travers un pavillon centré sur l’élément feu.















Conférence
Texte de la conférence
Conférence
Médiation culturelle et art contemporain
Paul Ardenne
Historien de l’art, critique d’art, curator, essayiste et romancier.
Maître de conférences à l’Université d’Amiens.
Gabès Cinéma Fen
Édition 2019
Synopsis
Le caractère « surgissant » de l’art contemporain, son actualité intense, son caractère très diversifié rendent délicate sa médiation auprès des publics. Entrer dans l’œuvre d’un artiste n’est pas chose aisée, surtout à l’heure de l’accélération de l’information et de la rotation des modes, qui tendent à rendre la création artistique plus éphémère que jamais. Comment faire pour « médier » à sa mesure, au vu de telles circonstances, l’art contemporain ? Sur quels principes et valeurs s’appuyer ?
Biographie
Paul Ardenne est historien d’art, commissaire d’exposition, critique d’art et écrivain.
Il est l’auteur de nombreux essais. Il collabore depuis 1990 à des revues telles que Art Press, Beaux Arts magazine, Omnibus, Le Voyeur, La Recherche photographique, L’Image, Parpaings, Visuels, Archistorm, Nuke, Synesthésie, L’Art même (Belgique), Esse arts + opinions (Canada) ou Figures de l’art en France, dont il est membre du comité de rédaction.
Paul Ardenne donne des conférences dans tous les domaines de l’art et de l’architecture, ainsi que dans le domaine de la vidéo d’art. Depuis décembre 2011, il participe en qualité de conférencier à des soirées bimensuelles de projections vidéos à thème, appelées Videoforever, organisées par Barbara Polla. Ces sessions académiques, qui ont pour objectif de promouvoir l’art vidéo, se déroulent dans divers lieux et pays notamment au Palais de Tokyo, au Musée de la chasse et de la nature, à l’atelier de l’artiste Frank Perrin, à Helsinki, à Sydney, à Station Beirut.
Texte de la conférence
Bonjour à toutes et à tous.
Je veux d’abord remercier les organisateurs de ce festival pour leur sympathique invitation. Et d’emblée, relever ceci, le thème de notre conférence étant la « médiation culturelle », dans le domaine, notoirement, de l’art contemporain : vu le succès public que rencontre, outre le festival Cinéma Fen, « Cinéma et art », de Gabès, nul doute qu’il ne soit, à sa manière, avec sa forme originale propre, un parfait exemple de « médiation »
La médiation, donc. Et plus spécifiquement la médiation culturelle. Et plus spécifiquement encore, en cascade, la médiation de l’art contemporain.
Je vous prie d’emblée de bien vouloir m’excuser de m’exprimer en français mais, hélas! pour moi, je ne pratique pas la belle et voluptueuse langue arabe. Cette langue française, vous ne le savez que trop ici, a été jadis celle de l’infâme colonisateur, un colonisateur – français, en l’occurrence – dont je n’entends pas endosser la figure et les pratiques. Je m’adresse ici en tant qu’homme libre venu d’Europe à des femmes et à des hommes libres de Tunisie, sans en aucune manière entendre faire la leçon mais dans le but d’exprimer un point de vue qui n’a rien d’autoritaire, et qui bien sûr gagnera à être contesté.
Le sens du terme « médiation », nous dit le dictionnaire, est celui-ci :
« Entremise qui a pour but de faciliter un accord. »
Synonyme : « conciliation« .
On aura remarqué, en termes lexicologiques, le rapport entre la médiation et les notions d’arrangement, de connexion, de relation diplomatique. La « médiation », c’est ce qui permet une meilleure communication, une meilleure compréhension, l’apport d’une information claire qui nourrit la connaissance de celui qui reçoit l’information. La bonne médiation, comme nous l’enseigne la méthode diplomatique, donne à la fraction des communicants qui ne sait pas la plus limpide des informations, distribuée par ceux qui savent.
Ce que réalise la festival d’art contemporain de Gabès, d’une impeccable lisibilité, qu’il s’agisse de la présentation des oeuvres d’art et de la rencontre possible avec les artistes, dans le cadre éclairé de discussions ouvertes et détendues.
Le caractère « surgissant » de l’art contemporain, son actualité intense, son aspect très diversifié rendent délicate sa médiation auprès des publics. Entrer dans l’oeuvre d’un artiste, bien souvent, n’est pas chose aisée, surtout à l’heure de l’accélération de l’information et de la rotation des modes, qui tendent à rendre la création artisitique plus éphémère que jamais. Comment faire pour « médier » à sa mesure, au vu de telles circonstances, l’art contemporain ? Sur quels principes et valeurs s’appuyer ? C’est ce que nous allons essayer de voir.
Une première donnée à prendre en compte en matière de médiation de l’art contemporain est l’accroissement exponentiel, depuis un demi-siècle, de ses canaux de présentation et de valorisation. Les musées et centres d’art se sont multipliés à grande vitesse depuis les années 1980 et ce, pas seulement dans les pays les plus riches ou les plus développés du monde. Les événements de type biennale, pareillement, se sont multipliés. En 1970, outre la Documenta de Kassel, qui a lieu tous les cinq ans en Allemagne, on comptait cinq biennales d’art contemporain dans le monde : Venise, Whitney Museum de New York, Sao Paulo, Cuba et Paris de manière irrégulière. En 1990, ce nombre était multiplié par quatre au moins. En 2010, Thierry Raspail, un des fondateurs de la biennale de Lyon, à qui je demandais : « Combien y a-t-il aujourd’hui de biennales d’art contemporain dans le monde », me répondait : « Au moins 400. » 400? Le chiffre avait de quoi surprendre. Et Thierry Raspail, là-dessus, de commencer à m’énumérer toutes les biennales grandes et petites que l’on trouvait çà et là, partout, même dans les endroits les plus reculés du globe, et de me rappeler malicieusement que rien qu’en France, un vieux pays qui a certes une relation intense avec la culture, il y a 1 700 festivals chaque année et pas moins de 350 fondations (plus de 400 aujourd’hui) dont un bon nombre se consacrent tout ou partie à l’art contemporain.
Si l’on ajoute à cette offre expositionnelle devenue pléthorique l’offre des galeries d’art, qui font un vrai travail de médiation, celle des revues d’art, celle des émissions télé ou web dédiées, celle des colloques consacrés à la création plastique contemporaine, celle des foires elles aussi toujours plus nombreuses, celle des ouvrages savants enfin, sans oublier l’ouverture de l’université à l’enseignement de l’histoire de l’art le plus contemporain qui soit, force est de convenir que ce type de création bénéficIe d’un éventail médiatique sans pareil, comparable en fait à celui du cinéma, du livre ou de la musique, qu’elle soit populaire ou savante. Sachant qu’il faut ajouter encore à cette donnée structurelle une autre donnée, d’ordre relationnel cette fois. Longtemps, on pouvait se sentir un peu seul en visitant une exposition d’art contemporain, seul au point d’être abandonné à sa solitude devant une création non forcément lisible et sémantiquement accessible de prime abord. L’art contemporain, entre tous les médiums de création, est le plus expérimental, le plus ouvert qui soit en matière de recherche poétique et esthétique. Ce critère expérimental et d’ouverture a pour conséquence sa nature fréquemment inassimilable dans l’instant si l’on ne possède pas le code d’entrée. Ce temps de solitude face à un art mal compréhensible, pour nous autres spectateurs, est pour l’essentiel révolu. Tout musée, tout centre d’art forment, à l’occasion de chaque exposition, des médiateurs empressés dont la fonction est de vous renseigner sur la nature des oeuvres exposées, outre la mise à disposition d’un programme spécifique pour les scolaires, toujours plus nombreux dans les lieux d’exposition.
Tout va bien ? On pourra le croire, au vu de ce bilan, dont je n’exagère en rien la teneur. Et, du coup, mon propos s’arrête là. Du moins, il s’arrête là si l’on considère que la médiation culturelle, en tout et pour tout, est une question de structure, d’organisation, de mise à disposition par les pouvoirs politiques responsables du matériau nécessaire de médiation.
Au vrai, la médiation culturelle, et en elle celle de l’art contemporain n’est pas, ne saurait être seulement une affaire structurelle. Elle est aussi conjoncturelle et, comme telle, assujettie à un nombre important de critères aussi essentiels que la morale publique, la question politique, le niveau de liberté d’expression consenti par les autorités, la mode. Une anecdote signifiante, pour en rendre compte. Voici quelques années, Philippe Terrier-Hermann, artiste français, est invité à la biennale de Sharjah-Dubaï avec beaucoup de générosité. On lui offre en effet de quoi produire une vidéo d’exposition qu’il n’a pas personnellement les moyens de financer. Mais sitôt l’oeuvre projetée, en amont de l’ouverture de l’événement, on lui demande très aimablement de corriger certaines scènes, celles notamment où des femmes montrent leurs épaules nues. Il ne s’agit pas là de critiquer cette manifestation mais de savoir, artiste, ce qui y est autorisé et ce qui ne l’est pas, qui n’est d’ailleurs pas explicitement précisé. La nudité? Interdite. La vue du sang? Interdite également. Les scènes de violence? Interdites aussi. On se rappelle comment, il y a une petite dizaine d’années, la sculpture monumentale d’Adel Abdessemed montrant le coup de tête, lors de la finale France-Italie du Mondial de football 2006, de Zinedine Zidane à Marco Materazzi, exposée sur la corniche du musée de Doha, a été promptement retirée à la demande des autorités de cet émirat du Golfe persique. Parce que le Qatar recevra la prochaine coupe du monde de football ? Non. Parce qu’il s’agit d’une scène brutale valorisant peu ou prou un geste sportif très inamical, et indigne ? Non plus. La raison de ce retrait est d’origine populaire. Sur les réseaux sociaux qataris, on s’émeut que deux sportifs, à travers une sculpture, puissent faire l’objet d’une célébration publique. Comme l’écrit alors un internaute, « Nous n’avons à adorer personne à l’exception de Dieu ».
Ces exemples, empruntés tous deux au monde arabo-musulman, pourraient être jugés tendancieux. Comme à dire en filigrane : cette culture arabo-musulmane qui est aussi la vôtre, en Tunisie, est une culture des interdits, de la censure, du contrôle politico-religieux de la pensée et de la représentation. J’entends être bien clair : ce type de situation, loin de se cantonner à votre aire de civilisation, se retrouve partout, y compris dans les États politiques qui se targuent d’être les plus puissants émissaires de la liberté d’expression. Prenons le cas des États-Unis d’Amérique, à travers l’évolution des biennales du Museum Whitney of American Art, établi à New York, qui donnent le pouls de l’art américain contemporain. Pour avoir longtemps couvert cet événement pour la revue française art press, et pour le couvrir encore, j’ai pu remarquer incidemment comment les sélections d’artistes opérées par les commissaires y décalquaient en fait les grands courants de l’évolution politico-morale du pays. Autour de 2000, on trouve encore ici des images de violence, de sexe hétérosexuel, la dominante des artistes est blanche, l’art outsider de type street art est exclu car considéré comme trop populaire. Quelques années plus tard, la représentation des artistes gay et lesbiennes augmente, à l’égal de la représentation politique du mouvement LGTBQI dans la société civile. Autour de 2010, on en vient à compter dans la sélection, lors de certaines éditions, plus d’artistes femmes que d’artistes hommes : c’est là la conséquence peu surprenante de la montée en puissance d’un féminisme attaché à faire sauter le couvercle discriminant du « plafond de verre », qui écarte massivement les femmes des postes de pouvoir. À partir de 2010, les artistes natives font leur entrée dans la biennale, eux qui ont été jusqu’alors tenus pour négligeables et d’aucun intérêt, tandis que la fraction blanche diminue : bienvenue aux afro-américains, aux indiens de l’île de la Tortue, aux chicanos d’origine mexicaine. Là encore, la sélection de la biennale se moule sur les revendications indigénistes qui secouent au même moment le continent américain, du Canada à la Terre de feu.
L’exemple des biennales du Whitney Museum est instructif, il signale que l’art est la caisse de résonnance de la société où il éclot et, au-delà de la création elle-même, qu’il ne peut pas exister de médiation culturelle sans des choix culturels spécifiques. Cet exemple signale aussi que les choix opérés en matière de médiation sont toujours sélectifs, qu’ils s’arc-boutent concomitamment sur l’état mental de la représentation politique qui est celle d’un État ou d’une aire de civilisation à un moment donné de son histoire et des évolutions propres à ce devenir historique. Au passage, on note si besoin était que la liberté d’expression n’a jamais pour corollaire la liberté de médiation. Exprimez-vous librement : parfait. Si l’on vous ferme tous les canaux de médiation, en revanche, personne n’entend ni ne voit ce que vous avez à exprimer. Comme le disait Andy Warhol, « ce qui n’est pas vu n’existe pas », formule que l’on peut traduire de la sorte, ce qui n’est pas médié n’apparaît pas.
Puisque nous nous entretenons de la question de la médiation culturelle dans le cadre du festival de cinéma et d’art (Cinema Fen) de Gabès, je voudrais faire un parallèle que beaucoup déjà, en m’écoutant, n’auront pas manqué de faire. En matière de médiation, et si les structures peuvent différer, il est des convergences notoires entre le domaine du cinéma et celui des arts plastiques, une convergence qu’on ne retrouve pas forcément dans tous les domaines de création. Prenons la littérature. Vous écrivez un livre ? Pas de problème, vous pouvez l’éditer à compte d’auteur, en diffuser les contenus sur les réseaux sociaux, pour un coût faible voire quasi nul. Vous réalisez des tableaux, des sculptures ? Au-delà du coût de la fabrication des oeuvres, il va encore falloir se poser la question de leur exposition, de la promotion de cette exposition, de la rédaction et de l’édition d’un catalogue, de l’organisation d’un vernissage, autant de postes coûteux.
Revenons au cinéma. Vous réalisez un film ? Attention, dans ce cas il va vous falloir un budget, une équipe, un contrat de diffusion, un réseau de salles et de festivals pour accueillir votre création. Les coûts, rapidement, ont toutes les chances d’exploser, ce qui vous rend dépendant de la production. Si, cinéaste, vous pouvez bénéficier d’un producteur bienveillant, tant mieux. Le fait est que c’est rarement le cas, le producteur étant légitimement intéressé à la productivité commerciale de votre film. Si ce dernier promet de ne rien rapporter, ne rêvez pas, il a toutes les chances de ne jamais exister.
Je voudrais à ce propos me faire l’échotier d’un propos du documentariste français Pierre Carles, auteur de plusieurs reportages polémiques sur la vie politique française (La Sociologie est un sport de combat, ou encore Pas vu, pas pris). Carles, quand il évoque ses débuts dans le métier dans les années 1990, parle de sa très grande latitude de travail. Le matériel, alors, ne coûte pas cher, les équipes de tournage sont minimalistes, on peut présenter ses films dans des festivals militants ou à l’invitation d’associations de bénévoles. À mesure que le temps passe, relève-t-il, travailler devient toutefois pour lui de plus en plus difficile. Les coûts augmentent sans cesse, ceux de la fabrique du film, ceux de l’exploitation commerciale et de la participation aux festivals, des conditions sont mises à la diffusion, la production pose un regard de plus en plus appuyé et lourd sur les contenus filmiques, il faut aller mendier de l’argent à des commissions qui s’assimilent parfois à des comités de censure… Bref, notifie Pierre Carles, si la liberté d’expression, en France, ne diminue pas avec le temps, l’opportunité d’en profiter et de la mettre à l’épreuve, elle, s’avère de moins en moins offerte. Résultat, dit le documentariste, « je ne peux plus prétendre faire aujourd’hui les films que je faisais il y a vingt cinq ans ». Fin de la parenthèse cinéma.
Toute médiation culturelle, on l’aura compris, est conditionnelle. Elle s’inscrit dans la logique – logique complexe, changeante, parfois régressive – des représentations mentales d’une société, représentations mentales avec lesquelles les créateurs peuvent certes jouer mais qu’ils peuvent difficilement culbuter ou ignorer. Si le droit à la critique n’est pas exclu, la subversion, elle, l’est. On n’a encore jamais vu une peinture, une installation, un livre, un film, un opéra, un poème, une pièce de théâtre renverser un régime politique établi. Non pas que l’art n’ait pas vocation à « changer la vie transformer le monde », pour reprendre la formule du tandem Rimbaud-Marx, il demeure un domaine dont le fondement sont les représentations et les avatars. Sa potentialité activiste, du coup, demeure limitée.
Je n’entends évidemment pas dire que la création culturelle est aux ordres du pouvoir et, si l’on pose que le pouvoir contrôle les canaux de médiation, que la création, en bout de course, se retrouve aux ordres de la médiation elle-même. On suggère ici, plus prudemment, que la création élue médiatiquement n’est pas, ne peut pas être toute la création. Tout créateur, de fait, n’a pas droit au maximum de médiation qu’il mériterait. Il y a incontestablement une « part maudite » de la création, le fait, nommément, qu’elle ne soit pas toujours et immanquablement médiatisée comme elle mériterait de l’être. Je voudrais citer sur ce point l’écrivain français Raymond Roussel, lorsqu’il a publié en volume ses Impressions d’Afrique, en 1909. Le jour de la publication de ce très insolite roman, Raymond Roussel s’attendait à une véritable révolution. Ses Impressions d’Afrique allaient chambouler le champ culturel, aucun doute sur ce point. Or il a dû déchanter : rien ne s’est passé, à son grand désarroi. Une autre anecdote du même genre émane de James Joyce, qui s’apprête à publier son roman fleuve Finnegan’s Wake au moment où Hitler attaque la Pologne et enclenche le processus de ce qui va devenir la Deuxième Guerre mondiale. Que dit Joyce, en substance ? Cet abruti d’Hitler, avec sa guerre, va monopoliser toute l’attention et va m’enlever toute chance de publiciser mon roman.
Primat de la médiation sur la création ? On n’ira tout de même pas jusque là. On pointera toutefois que les créateurs, bien souvent, ont eu soin de créer leur propre structure de médiation. Sage principe de précaution. Le peintre français Gustave Courbet, en 1855, installe son Pavillon du Réalisme à l’entrée de l’Exposition universelle de Paris. Richard Wagner, à Bayreuth, invente un théâtre spécial où seront jouées ses oeuvres, sous son propre contrôle. Plus récemment, dans les années 1980-1990 et pour cause de fonte des aides publiques à la culture, les artistes plasticiens anglais, italiens, français… initient leurs propres artists run spaces, des espaces d’exposition où ils gèrent eux-mêmes la médiation de leur création.
Le rôle de l’artiste, pour autant, est-il de prendre en charge la médiation de son propre travail ? La logique ne voudrait-elle pas que l’artiste s’appuie, plutôt, sur les structures de médiation existantes ? Le problème, une fois prise cette décision-là, c’est cette question cruciale : comment cet artiste qui s’en remet au système de médiation existant peut-il être sûr que sa création sera sélectionnée, et qu’elle sera promotionnée ? D’ailleurs, y a-t-il des choses que le monde médiatique aime plus que d’autres ? Le monde médiatique apprécie-t-il en premier lieu les oeuvres d’art faciles d’accès, ou au contraire, celles qui se révèlent plus difficiles ? Car à n’en pas douter, toute structure de médiation, qu’il s’agisse d’un musée, d’un centre d’art, d’une revue, d’une unité d’enseignement universitaire… a incontestablement ses préférences, ses lubies peut-être.
Prenons l’exemple français et, dans la France actuelle, les « recommandations » implicites dont résonne, à l’heure où je vous parle, l’univers culturel. Quelle est en ce moment l’oeuvre qui a toutes les chances d’être la mieux reçue ? Procédons en écrivant un scénario. La diversité identitaire et la mixité doivent être défendues par la République, tel est l’un des principaux crédos de la politique française actuelle. Notre scénario de l’oeuvre d’art doit-il compter deux personnes principales, intégrons d’office un pauvre, un homme, mettons, qui vient du Nigeria, et une autre personne, mettons une femme cette fois, riche et qui vient des beaux quartiers de Paris ou de Romorantin. Autre recommandation nationale : la lutte contre l’homophobie. Notre Parisienne, notre Romorantinienne est en fait un parisien, un romorantinien, c’est un transgenre. Autre recommandation : la vie éthique. Les deux protagonistes de notre scénario mangent vegan, ils consomment équitable, ils ont fait installer des panneaux solaires sur le balcon en terre battue de leur éco-appartement, ils cultivent du cresson certifié Bio-Cop dans les jardinières à géraniums et pédalent sur un home trainer spécial qui produit l’électricité dont ils ont besoin. Notons que tous deux portent des vêtements qu’ils ont fabriqués eux-mêmes avec leurs petites mains après avoir acheté de la laine de mouton à un éleveur du coin, selon le modèle vertueux du circuit court. Autre recommandation venue du sommet : lutter contre les violences faites aux femmes et aux personnes faibles, dans la lignée du mouvement « #MeToo ». Notre homme, tant qu’à faire, est un homme battu, une victime. Continuons notre petit jeu de la définition de ce qui fait « valeur » aujourd’hui au-delà des Pyrénées, le scénario entre tous idéal au vu des « recommandations » culturelles d’État françaises. Relevons donc encore que notre Nigérian est un émigré clandestin, qu’il a traversé la Méditerranée sur un boat people et qu’il a miraculeusement survécu à son périlleux voyage vers la France grâce à l’aide d’une Allemande de l’ONG « Accueillons tous nos frères et soeurs du Sud » et d’un passeur repenti qui a trouvé la lumière en assistant par hasard à un cercle de parole ayant pour thème « La solidarité est le salut de l’être humain », séminaire animé par un prêtre pédophile lui aussi repenti. Ce genre de scénario vous paraît bourré de clichés, trop « tendance », mainstream ? à tout coup, il vous vaudra pourtant la reconnaissance des instances politiques en charge de définir la politique d’État en matière culturelle. Bien sûr, ne vous appelez surtout pas Donatien Alphonse François de Sade et n’écrivez en aucun cas des romans brutaux où les gens se torturent et s’assassinent, louent la débauche permanente et la pratiquent en se faisant caca dessus, insultent Dieu et leur prochain tandis que des hommes mal intentionnés mettent des rats dans le vagin des femmes, avant de recoudre en disant crânement « Bien fait ! ». Strictement inenvisageable.
Bien sûr, je caricature – encore que. Il ne vous aura pas échappé, en matière d’art contemporain mais aussi au-delà, que la médiation culturelle est en ce moment, çà et là de par notre vaste monde, en butte aux pires « recommandations » (je mets ce terme entre guillemets). Au nom de l’identité première, par exemple. En 2017, lors de la biennale du Whitney Museum déjà évoquée, un artiste noir (Parker Bright) vient se ficher debout, sans bouger, devant une toile qui représente le cadavre d’un gamin noir tué par des suprématistes mais qui a pour caractéristique d’avoir été peinte par une plasticienne blanche (Dana Schutz). Quel est l’argument ? Un blanc n’a pas le droit de peindre l’image d’un noir, seul un noir en a le droit. Un peu plus au nord et à peine plus tard, à Montréal, au mois de juin 2018, l’homme de théâtre québécois Robert Lepage, dans le cadre d’un festival de jazz, met en scène le spectacle musical SLAV, qui présente des chants d’esclaves noirs d’Amérique, spectacle ainsi décrit officiellement : « SLAV est une odyssée théâtrale à travers les chants traditionnels afro-américains, des champs de coton aux chantiers de chemins de fer, des chants d’esclaves aux chansons de prisonniers recueillies par John et Alan Lomax dans les années 1930″. Un comité de résidents noirs, via des manifestations publiques, fait alors pression sur la direction du festival, qui annule le spectacle, au prétexte que tous les chanteurs qui animent le spectacle ne sont pas noirs mais aussi parce que le metteur en scène n’a pas demandé l’autorisation (sic) de monter ce spectacle aux associations afro-américaines locales.
On pourrait, malheureusement, multiplier les exemples de cette mise sous condition, de cette mise au carreau de la création par la médiation. On pourrait aussi évoquer, tant qu’on en est à lister le volet noir de la question, le devenir économique de la création, qui n’est médiée que si elle rapporte suffisamment. Encore, rappeler la destination animationnelle de plus en plus recherchée par les médiateurs culturels, au prétexte que l’oeuvre d’art doit être distrayante, nourrir un climat de divertissement, d’entertainment, climat apaisé et joyeux qui fait du bien à tous et permet à bon compte d’acheter la paix sociale. Le cas que représente l’évolution du street art, à cette entrée, est tristement éloquent. Au départ, quoi ? Une création clandestine, dissidente, où l’artiste de rue essaie d’affirmer une identité qui lui est refusée, pour fait de discrimination sociale, identitaire ou territoriale. Et à l’arrivée ? Pour solde de tout compte, une pratique d’art bénie par des municipalités toujours plus nombreuses qui offrent des murs aux taggers et organisent des festivals officiels de street art dont la vraie création fait les frais, consensuels en diable, prodigues d’une imagerie de la pseudo-révolte et du fantasme de la réconciliation sociale retrouvée.
Toute médiation culturelle, se voudrait-elle apolitique, ne l’est pas. Elle est politique. Il convient bien, à cette entrée, de se méfier des États démocratiques – ou, comme on le dit de plus en plus, « post-démocratiques », qui n’ont plus de démocratiques que le nom – dans la mesure où ceux-ci, loin de limiter en apparence l’expression artistique, la canalisent en fait en usant de la médiation comme d’un entonnoir. Création hyperbolique, inflationniste, en nombre mais hypobolique, mesurée, en terme de médiation. Beaucoup de créateurs mais très peu de créateurs médiés et élus.
Pour être tout ce qu’il y a de plus concret, pour éviter aussi le reproche de trop généraliser et, à mon tour, de faire de la politique (une politique favorable au discours scientifique, contre celui de la mise en scène et du spectacle), je voudrais faire allusion à un événement récent, promu au plus haut niveau par l’Union Européenne, la dernière édition de Manifesta, la douzième, qui a eu lieu à Palerme, en Sicile, de juin à novembre 2018.
Manifesta est « la » biennale d’art européenne. Sa première édition a eu lieu en 1996, à Rotterdam (Pays-Bas). Particularité : elle est itinérante. Chaque édition de cet événement élit une ville ou une région différentes : Luxembourg, Ljubljana, San Sebastian, Murcia, Saint-Pétersbourg, Zurich… ou encore le Haut-Adige ou le Limbourg, depuis ses débuts. Émanation de l’Union Européenne qui la finance en large part, Manifesta est née d’une volonté de rapprochement avec l’est européen suite à la double chute du Mur de Berlin et de l’Union soviétique. Ce positionnement originel, avec le temps, s’est modifié, dans cette optique : mettre en valeur des créations plasticiennes dont la thématique principale entre en écho avec les préoccupations du continent européen.
Manifesta a pris l’an passé ses quartiers à Palerme, Capitale Européenne de la Culture 2018 et métropole portuaire de Sicile connue pour ses nombreux croisements identitaires (la cité a été successivement grecque, romaine, musulmane et chrétienne) et pour la violence endémique qu’y fait régner la mafia. Le thème de cette 12e édition, thème plutôt ancré dans l’air du temps, était « Le Jardin planétaire. Cultiver la coexistence », inspiré pour partie des théories de Gilles Clément, jardinier et théoricien oecuménique. « Jardin planétaire » ? « Diversité, mouvement, assemblage entre les êtres vivants : la nature offre les richesses de son paysage à l’homme-jardinier, écrit Gilles Clément. À celui-ci d’organiser son territoire et d’y ménager la vie selon sa culture et à son échelle. Prélever sans appauvrir, consommer sans dégrader, produire sans épuiser, vivre sans détruire, c’est possible (….). Le jardinier, citoyen planétaire, agit localement, au nom et en conscience de la planète. » [1]
Manifesta 12, ce sont une cinquantaine d’artistes d’origine différente, européens surtout. Ceux-ci présentent une centaine de travaux dans une multitude de lieux d’exposition, anciens palais, églises et autres demeures de prestige ouverts pour l’occasion au public. Exposition fort touristique que celle-ci, mais faut-il s’en plaindre? On y oblige en tout cas le visiteur à crapahuter des heures durant pour trouver les différents sites d’exposition et, ce faisant, à prendre la mesure d’une ville à l’exceptionnelle beauté, dont le passé faste a laissé bien des marques. La notion d’in situ, totalement galvaudée, doit au passage être repensée. Pour l’essentiel, aucune des œuvres présentées n’entretient ici de rapport naturel ou critique avec le lieu où elle est installée. Priorité à l’animation culturelle tous azimuts.
Deux axes structurent cette exposition collective. Le premier est l’écologie, comme le suggère l’intitulé général. Le second est la question de l’autre, rapporté pour l’occasion à la figure du migrant, ainsi que le suggère encore l’intitulé général, dans sa seconde partie cette fois, « Cultiver la coexistence ». Le tout se veut le reflet d’une réalité non pas seulement européenne mais globale aux airs de catastrophe universelle. «Manifesta 12 Palermo explore la coexistence dans un monde mu par des réseaux invisibles, des intérêts privés transnationaux, l’intelligence des algorithmes, la crise environnementale et des inégalités croissantes », peut-on lire sur la brochure de présentation de l’événement. Nous voici prévenus. Inutile d’attendre de cette manifestation l’expression de positionnements solitaires, idiosyncrasiques. Prière à la solitarité de laisser place à une solidarité de principe. L’art européen respectable, doit-on croire ? C’est celui-là seul qui prend à bras le corps les tensions du Vieux continent et, tant que l’on y est, du monde.
Première entrée, le combat « vert ». De multiples créations recyclent pour l’occasion les thèmes de l’agriculture bio (Cooking Sections, What is Above and What is Below ; Leone Contini), du respect des ressources (Malin Franzén, Palermo Herbal ; Alberto Baraya, Michael Wang…), du retour à la nature (Zheng Bo, Pteridophilia), du refus de la violence végétale (Fallen Fruit, Theatre of the Sun) et animale. On compte à cette entrée peu d’œuvres réellement intéressantes mais l’on y gagne cette certitude : le greenwashing opère dans le champ artistique aussi. Veux-tu, artiste, être repéré.e ? Fais dans le « green ».
Seconde entrée : l’accueil de l’étranger. Manifesta 12, à ce sujet, offre une inflation de créations dont les migrants, africains notamment mais aussi syriens, sont le thème obsessionnel. Filmés sous toutes les coutures, interrogés et promenés comme des trophées (Marinella Senatrore, Palermo Procession), leur vie disséquée de part en part, ils constituent ici ce précieux carburant grâce auquel une notoire bien-pensance se donne cours (l’autre ? Mais comment peut-on lui refuser les portes du Paradis ?). Près de 20 000 migrants, depuis 2011, se sont noyés en tentant de traverser la Méditerranée (Forensic Oceanography, Liquid Violence) ? Donnons la parole aux survivants. Donnons-leur la parole, notons-le bien, à défaut de les accueillir réellement, en un moment où en Italie même le vice-président du conseil et ministre de l’Intérieur Matteo Salvini a interdit l’accostage des navires humanitaires chargés de rescapés récupérés en pleine mer sur des embarcations de fortune et sauvés d’une noyade prévisible.
À bon droit, le visiteur peut être choqué, à Palerme même, par ce contraste saisissant, le grand écart qu’il ne manquera pas de constater entre la situation concrète des migrants, misérable, clochardisée, et leur représentation, pas loin d’être héroïsée. Sur les cimaises des expositions de Manifesta 12, quoi ? Les images de migrants à qui l’on reconnaît une forte humanité, auxquels on témoigne des trésors de reconnaissance, de la dignité (Uriel Orlow, Wishing Trees, Erkan Özgen, Purple Muslim, Peng! Collective, Werde Fluchthelfer.in!). Et dans la rue, juste en bas, quoi ? Les mêmes migrants, cette fois en chair et en os, dans leurs tentes Quechua, essayant de tuer le temps et de se faire trois sous comme ils peuvent, sans autre perspective que celle d’attendre une évolution improbable de leur sort sous l’œil surtout indifférent ou méprisant des populations locales.
Troisième entrée : la stance humaniste positive. Indéniablement, à en juger par nombre de travaux artistiques présentés par Manifesta 12, la culture de la « gentillesse » (Kindness) progresse à pas de géant. Non-violence, recherche de l’harmonie (parfois jusqu’au ridicule : Melanie Bonajo, Economy of Love), appel récurrent à la fraternité sont ici de véritables invocations, le plus souvent niaises ou naïves qui plus est, un «Aimons-nous les uns les autres » post-chrétien et version sociale-démocrate. Les artistes seraient-ils des relais, des courroies de transmission de l’idéologie européenne, connue pour se gargariser, sur le mode d’un prêchi-prêcha automatique, de l’affirmation solennelle du droit humain – ce droit serait-il par ailleurs bafoué dans maints états de l’Europe communautaire ? Appréhendé dans cette lumière manipulatrice, Manifesta 12 est sans conteste un instrument culturel de propagande.
Soyons clairs : pas question de vilipender les contenus de Manifesta 12, et nommément l’engagement des artistes pour un monde meilleur, plus juste, plus propre, plus fraternel. Ce type de positionnement va dans le bon sens. Reste que trop de consensus mis sur l’étalage donne la nausée. Seul le politiquement correct, en ces lieux, semble recevable, apte à trouver droit de cité. Manifesta 12, biennale d’art politique, plus exactement dit « écopolitique », pêche à cet égard par son absence d’ouverture (un comble !) et par son affichage trop idéologique. Si créer c’est résister, selon le bon vieil adage deleuzien, alors Manifesta 12 et son contenu artistique sont dans le vrai. Si créer, dans une tout autre perspective, c’est se perdre, fuir le réel, écrire une légende qui trafique avec les turpitudes de l’époque et les travestit complaisamment, alors Manifesta 12 est un ratage complet. À chacun de peser le pour et le contre, selon son option personnelle.
J’en viens à présent à la fin de ce rapide, trop rapide tour de piste relatif à la question de la médiation culturelle en art contemporain et plus largement. Si une thèse est défendue dans mon propos – mais je me méfie des thèses, toujours simplistes dans un monde régi aujourd’hui par la complexité des situations, si j’osais dire : par la plus complexe des complexités des situations -, ce sera a minima celle-ci, que vous avez bien sûr tout loisir de discuter voire de rejeter : ce ne sont jamais les structures de médiation qui importent mais ce que l’on met en valeur – le programme, plus que la manière ou le médium proprement dit. Ceci, dans un cadre politique « structurant », diraient avec raison les néomarxistes. Le choix de ce qui est médié en priorité, celui, en creux et par voie de conséquence, de ce qui est exclu de la médiation relèvent d’un pouvoir culturel et par intention politique qui détermine le champ médiatique, voire qui le régit carrément, dans les pays autoritaires par exemple. Pour faire court, on ne peut pas penser la médiation culturelle sans l’inscrire dans la logique des conflits politiques.
Une donnée notoire, en matière de médiation de l’art contemporain plus particulièrement, est le rôle que les sociétés assignent, ou n’assignent pas, à cette forme de création. De ce rôle se déduit la manière dont on va médier la création. Il existe à cette entrée deux grandes tendances, celle des révélateurs et celle des prescripteurs. Le médiateur révélateur, attentif aux formes de création de son temps, s’évertue à les valoriser, il va essayer de leur donner une visibilité, il va s’attacher à montrer ce qu’apportent ces formes de création, comment elles viennent nourrir un champ culturel ouvert et en tendance à élargir, à rendre encore plus vaste qu’il n’est. Le médiateur prescripteur, lui, moins attentif aux formes de création émergentes de son temps qu’à celles qui lui paraissent devoir s’imposer, va s’attacher de son côté à faire valoir des créations qui vont dans le sens d’une instance qui leur est supérieure. Cette instance, quelle est-elle ? Le service ou la célébration du pouvoir en place, qu’il soit politique ou économique ; la consolidation de l’image des artistes qui oeuvrent en ce sens ; la promotion d’une propagande publique ou privée (les financiers Arnault et Pinault en France en ce moment, qui multiplient les présentations de leurs collections jusque dans les musées publics désargentés). Le médiateur prescripteur, qui diversement va défendre les intérêts d’un État, d’un courant esthétique, d’une idée politique, d’une ploutocratie, ferme le champ culturel là où le médiateur révélateur, lui, l’ouvre. Précisons que le médiation prescriptive – et on l’a bien vu, je crois, avec l’exemple de Manifesta 12, que j’ai détaillé pour vous – n’est pas le seul apanage des régimes politiques autoritaires. À travers la pratique du soft power, elle se décèle aussi dans les États les plus libéraux qui soient. On parle souvent en Europe, pour pointer son efficacité dans le domaine culturel, de la « propagande douce du libéralisme ». En ce qui concerne plus spécifiquement le champ de l’art contemporain, cette « propagande douce » va s’exercer par exemple à travers la valorisation d’artistes sur lesquels on peut spéculer, dont on parle sans cesse et que l’on surestime sans jamais les critiquer. Prenons, parmi d’autres, trois exemples de ces artistes survalorisés ostensiblement mis au service de cette « propagande douce », Jeff Koons, Banksy et JR. Si l’on s’en tient à l’esthétique des oeuvres que réalisent ces artistes très en vue et à la manière dont ils les réalisent, on n’y verra rien, ni de pionnier, ni de substantiel sur le plan poétique et esthétique : c’est classique, déjà vu, éculé, la réalisation plastique n’a rien de notoire, les contenus de ces oeuvres, enfin, sont creux ou rebattus depuis longtemps. Les artistes que nous citons, pour autant, alimentent sans fin l’actuelle chronique de la médiation artistique, ils sont sans cesse présentés comme des « papes » de l’art contemporain, sans discussion, sans que l’on prenne vraiment le temps de regarder de près les formes et les propos qu’ils véhiculent, qui relèvent tous de la bien-pensance ou de la pseudo-provocation.
Il ne s’agit évidemment pas de dresser le médiateur révélateur, celui qui dit : « Découvrons ! », contre le médiateur prescripteur, qui dit, lui : « Croyez ! Ne discutez pas ! Avalisez ! » Un même centre d’art, un même journal, un même théoricien, un même festival, à un moment-donné, peuvent être des « révélateurs » et, à un autre moment, se faire « prescripteurs ». De plus (et c’est là une des Ruses dont la raison est coutumière), « révéler » c’est un tant soit peu, toujours, « prescrire ». Prenons l’exemple du Festival Cinéma Fen de Gabès, puisque c’est à Gabès que présentement nous sommes. Si le Festival Gabès Cinéma Fen, sans conteste, est d’abord un festival de « révélation » (on y montre des artistes qui ne sont pas des stars de l’art contemporain tunisien ou international), on ne les y met pas moins en valeur, on y satellise leur carrière, on porte les spectateurs à accroître l’intérêt dont ces artistes bénéficient ou dont ils mériteraient de bénéficier. Bref, prudence, on avance ici aussi, parfois, entre les containers de la promenade de la plage de Gabès, en terrain miné.
Ceci posé, reste qu’il existe dans le monde de l’art contemporain et, plus vastement, dans le champ culturel tout entier une indéniable tension entre deux grandes tendances déjà évoquées plus avant, celle de l’expérimentation, celle du divertissement. La question centrale, en l’occurrence, n’est peut-être pas tant celle de l' »horizon d’attente » des publics, comme l’exprimait naguère le théoricien de la littérature allemand Hans Robert Jauss, mais celle de la manipulation de cet « horizon d’attente ». Si les instances de décision décident que le seul art à servir au public est celui qui divertit, le public ne pourra finalement que jouir d’un art de divertissement, qui occupe le temps agréablement. Si au contraire le pouvoir culturel en vient à décider que seules comptent les oeuvres expérimentales, seraient-elles parfois ardues à comprendre et à assimiler, alors ce même public devra se satisfaire d’oeuvres expérimentales. Non que le public ne puisse pas choisir : on n’est jamais obligé de suivre la masse et d’alimenter le troupeau. En revanche, si l’offre culturelle qui fait l’objet de la médiation se restreint, le choix offert au public lui aussi se restreint. Il devient plus difficile pour le public d’avoir une vue élargie, tandis que l’astreinte et la restriction de l’offre sont de plus en plus de rigueur.
Cette situation, en amont du public, les créateurs eux-mêmes, évidemment, la vivent. Des créateurs qui risquent d’être tentés de créer dans un sens ou dans l’autre selon la nature même de ce que la médiation met en valeur. À cet égard, les créateurs expérimentateurs, exigeants, audacieux, souffrent plus aujourd’hui que les créateurs conformistes ou intégrés dans le système de l’art. Jusqu’à ce point, la difficile intégration du créateur expérimentateur dans un univers culturel vendu en large part au divertissement, au spectaculaire, aux cultures de confort et à leurs premiers relais, les grands médias (des grands médias en France et autre part, rappelons-le, à peu près tous aux mains de grandes puissances d’argent), un univers culturel en tendance caractérisé par la mise à la marge des propositions radicales, inédites ou non conformistes. D’où il ressort, au plus léger, une frustration des créateurs, au plus sévère, leur colère et le sentiment juste d’être méprisés et tenus pour nuls, au plus triste, leur servilité, tandis que l’on se met à créer dans le sens du vent.
Cette situation n’est pas à proprement parler nouvelle. Elle émane des politiques d’encadrement culturel du second après-guerre, pas malvenues dans la mesure où ces politiques visaient au départ à élargir l’accès à la culture, dans le cadre du développement de l’État-providence et de préoccupations sociales et solidaires étendues (c’est là l’esprit de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, dont on vient de fêter le cinquantenaire). La situation que nous évoquons prend un tour problématique, cependant, lorsque l’encadrement culturel devient trop marqué, un phénomène qui émerge avec les années 1980 et que va renforcer l’irruption du postmodernisme, qui valorise avant tout la libre culture du goût personnel (« Si j’aime c’est bien et inversement »), contre celle de l’engagement ou de l’expérience qui caractérisait l’esprit moderne.
Finissons-en, à présent. En concluant par cette question essentielle : comment limiter l’exclusion des créateurs, sinon totalement (c’est impossible, le champ de la création est fécond à un point tel que l’on a peu de chances, hélas !, de pouvoir le mettre en valeur en tout), en tout cas le moins possible ? Nous savons qu’avec l’irruption, voici une petite quinzaine d’années, des réseaux sociaux numériques, la réponse à cette question a été donnée par les créateurs eux-mêmes. Les plasticiens, de plus en plus nombreux, exposent leurs travaux sur Instagram, lors même que dans le même temps les cinéastes projettent leurs films sur YouTube et que les musiciens, grâce à Deezer, proposent aux auditeurs, en ligne directe et sans intermédiaire, la musique qu’ils inventent. Cette réponse du berger à la bergère, du faible au fort, de la micropolitique à la macropolitique doit retenir toute notre attention. Elle ne signifie pas que l’ordre prévalant de la médiation culturelle, favorable aux unités instituées et riches d’influence et d’argent, va s’inverser. Elle signifie, plutôt, qu’une logique instrumentale établie est peut-être en train de se briser, au bénéficie du fractionnement, de la singularité, dans le cadre d’un espace culturel non plus fait d’un territoire de masse contrôlé mais d’une multitude de territoires de niches difficiles à contrôler tant ils essaiment.
Le défi de la médiation culturelle, pour les temps à venir, réside dans la prise en compte de cette double distribution de la culture, culture massive pour peuples manipulés et abrutis de divertissement d’un côté, et de l’autre côté culture segmentée en une infinité de créations destinée à des curieux isolés retors au système de la consommation culturelle de masse. Qui l’emportera, des deux groupes ? À défaut de le savoir, on peut pointer d’office que le combat a déjà commencé et que faute d’élire un vainqueur avant longtemps, de manière vraisemblable, cet affrontement historique verra tactiquement chaque parti se diluer dans l’autre, dans le but de le phagocyter. Où l’on retrouve, si tel est le cas, ces deux critères essentiels qui font les civilisations humaines, le pouvoir d’adaptation, l’art de la stratégie.
Je vous remercie.
Paul Ardenne
Gabès. Avril 2019